Thierry Paquot est philosophe de l’urbain et professeur des universités. Il a été pendant dix-huit ans l’éditeur de la revue Urbanisme. Il est l’un des rares philosophes à consacrer son œuvre à l’étude de la ville et de l’architecture, à travers une quarantaine d’ouvrages dont « Un philosophe en ville ». Dans cet essai, publié en 2011, Thierry Paquot interroge le rapport de l’homme à son habitat, et aborde divers thèmes tels que la marche, l’hospitalité, la banlieue… En répondant à nos questions, Thierry Paquot prolonge un temps cette passionnante promenade en idées dans l’univers urbain.
Thierry Paquot, en quoi la réflexion philosophique peut-elle nourrir le travail des « faiseurs de ville », urbanistes, architectes, designers, paysagistes ?
La philosophie concerne tout individu, puisqu’il s’agit d’un art de vivre. Mais c’est également une manière de rendre intelligible le monde dans lequel nous vivons, or celui-ci dorénavant est urbain. Je constate non sans tristesse que les praticiens de la ville sont peu enclins à s’y intéresser, à part peut-être quelques designers, car ils travaillent sur le corps, les sens, les rapports que nous entretenons avec les objets ordinaires, les matériaux, les éléments.
Je dois vous avouer que j’ai rarement rencontré des architectes me confiant que tel ou tel de leurs projets résultait d’une réflexion philosophique.
Du coup je préfère poser la question à l’envers, et me demander : quels sont les philosophes qui se sont intéressés à la ville ? La réponse n’est guère plus enthousiasmante, les philosophes « scolaires » (ceux qu’on enseigne au lycée et à l’université) ne nous disent pas grand chose sur le grand ensemble, le centre commercial, le gratte-ciel, les banlieues, la rue…
Néanmoins, quelques uns s’y intéressent, parfois de biais, c’est pourquoi j’ai voulu développer une philosophie de l’urbain et promouvoir à travers elle « l’indisciplinarité ». Pour répondre à des questions difficiles comme: « qu’est-ce que l’architecture ? » et « comment faire ville ? », il convient de cultiver cette indisciplinarité qui refuse les clivages disciplinaires et circulent dans tous les savoirs…
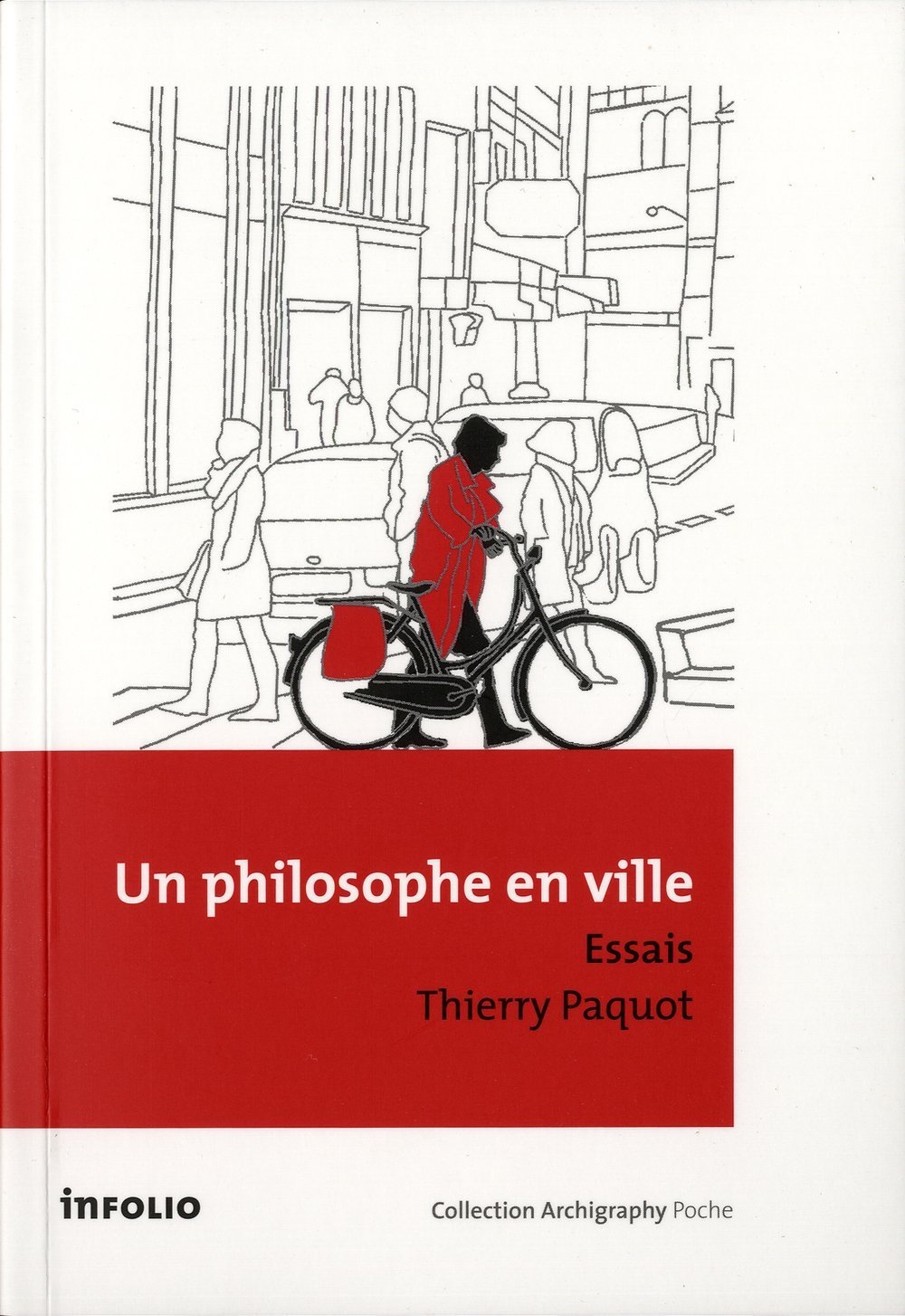
Couverture de l’ouvrage « Un philosophe en ville » par Thierry Paquot
Dans Un philosophe en ville, vous revenez sur l’expression « espace public », utilisée par le philosophe et théoricien Jürgen Habermas, et qui est aussi le titre d’un de vos ouvrages paru en 2009. Quelle en serait votre définition aujourd’hui ?
Avant tout je souhaite rappeler que Jürgen Habermas est un philosophe allemand né en 1929, qui rédige une thèse de philosophie sur Schelling en 1954, puis en soutient une autre en sciences politiques en 1961, publiée l’année suivante et traduite en 1978 en français sous le titre L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise.
Ce qu’il étudie, c’est la manière dont en Europe, de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, la conviction privée va bénéficier d’une certaine audience publique par le biais de trois « dispositifs », le journal, le café et le salon qui naissent dans les grandes villes à peu près au même moment. Votre opinion est alors amplifiée et diffusée par les lecteurs du journal dans lequel vous l’avez développée ou par celles et ceux qui vous ont entendu l’exprimer dans un café ou un salon.
Ainsi « l’espace public » facilite la publicité de votre point de vue privé, elle le rend publique. Habermas examine principalement l’expression de l’opinion des bourgeois, de ce tiers-état conquis aux idées des Lumières qui va accélérer la contestation de la monarchie absolue et la renverser.
Une telle conception de l’espace public, exclusivement politique, est très éloignée de la nôtre qui y met la voirie et les endroits réservés à des publics (parcs et jardins, centres commerciaux et galeries marchandes, plages et sentiers de randonnée…). Ce qui est commun à ces deux acceptions c’est la communication, le fait que cela circule, ici des idées, là des gens. Je préfère utiliser le terme de « lieu » urbain, peu importe son statut juridique (collectif, coopératif, privé, municipal, étatique,…) l’essentiel est qu’il soit doté d’une certaine urbanité. Ces lieux doivent être ouverts à différents publics, donc accessibles et gratuits.
Or je constate que la plupart de ces « espaces publics » sont de plus en plus privatisés, soit par les habitants eux-mêmes (comme dans la gated community), soit par des entreprises (magasins, centres commerciaux, musées, salles de spectacles, zoo…). En cela, je distingue les lieux urbains, comme les rues, les places et les parvis qui sont pour tous les citadins, des lieux réservés à des publics, avec une entrée discriminante…
Dans quelle mesure la qualité des bâtiments comme du mobilier urbain influence-t-elle la vie des usagers de cet espace public ?
Cela me paraît évident que chacun cherche à avoir la meilleure posture, aussi le mobilier urbain doit-il être le plus confortable possible. Je rappelle que le mot confort vient de « réconfort ». Je suggère d’utiliser le verbe « améniser », que je construis à partir du qualificatif « amène ». Un mobilier urbain « amène » est « aimable », il correspond aux attentes des usagers, quels que soient leur âge, leur taille… Par exemple on néglige souvent les enfants, dont le champ visuel est complet vers 11/12 ans. Je trouve que les designers sont assez peu soucieux de la diversité des publics, on leur demande de réaliser un produit standard, or nous devons être dans le sur-mesure, le cas par cas.
La qualité de l’espace public passe aussi, en plus de cette aménité, par la fantaisie. Je parle ici de la manière d’éclairer les rues, de fleurir les espaces. Il règne un conformisme étonnant dans nos municipalités. On voit toujours les mêmes arbres plantés de la même manière.
Il y a d’ailleurs un contraste saisissant entre ces espaces publics tous conformes et les jardins ou balcons privés qui sont bien plus foisonnants et variés. Le paysage urbain mériterait d’être harmonisé.

« Coulée verte » à Paris, près de la station de métro Châtillon-Montrouge
Vous évoquez l’idée que pour exister, un territoire exige de l’attention. Comment recréer des usages dans des territoires traversés et façonnés par les flux automobiles ?
Sans diaboliser l’automobile, il est certain que la coexistence des piétons et des automobiles est rarement pacifique. Quel plaisir que de découvrir autrement la ville, à pied par exemple.
L’ « aménité » d’une ville consiste en cette qualité de se sentir chez soi dans n’importe quelle rue. Bien sûr, cette rue possède des boutiques et des ateliers, les activités économiques ne sont pas concentrées en un centre commercial éloigné de plusieurs kilomètres et accessible uniquement en automobile. Le « tout automobile » entretient cette culture du centre commercial. Heureusement, la crise énergétique nous conduit à décroître nos déplacements, aussi irons-nous faire nos courses à pied ou en vélo, dans notre quartier ou bien encore nous faire livrer à domicile.
Redevenir piéton est bon pour la santé, nous sommes trop des sédentaires passant d’un fauteuil à un autre, sans même appréhender l’environnement que nous environnons, avec le déploiement inconsidéré de nos techniques. La plupart des automobilistes privilégient la destination au mépris de l’itinéraire…
Vous consacrez un chapitre aux rythmes urbains, et proposez aux municipalités d’observer les emplois du temps dans les micro-territoires des villes pour les modeler selon les attentes des usagers. Comment comprendre l’emploi du temps des territoires ?
Cela part d’un constat : pour récupérer un colis il faut faire la queue au bureau de poste, et donc pouvoir y aller en dehors de ses heures de travail. Cela n’est pas toujours possible.
Il faut donc que les horaires de ces lieux publics soient mieux adaptés. L’ensemble de nos activités est réglé par des temporalités administratives. Bien sûr on ne peut pas demander que tout soit ouvert tout le temps, cela voudrait dire qu’une partie de la population devrait travailler pendant que l’autre vivrait.
D’où l’idée d’une « Maison des Temps » – et non pas d’un « Bureau des Temps » qui créerait inévitablement une bureaucratie. Une « Maison des Temps » serait un lieu où l’on discuterait entre usagers, transporteurs, employeurs, syndicats, administrations, enfants, personnes âgées, etc., afin d’harmoniser les temps sociaux, contraints si vous voulez, aux temps de chacun. Il s’agirait de varier les horaires selon les différents moments des journées de la semaine mais aussi selon les saisons non seulement pour faciliter la vie quotidienne des citadins mais aussi pour améliorer la qualité des lieux urbains.
Pour cela il faudrait observer leurs usages temporalisés, qui sont différents selon le jour de la semaine, l’heure, la période, afin de fabriquer la ville à partir de ce que j’ai appelé la « chronotopie ». Mais cette démarche n’est pas appliquée, alors qu’elle vise le mieux-être des habitants, des économies d’énergie, une meilleure utilisation des bâtiments, etc. Si vous regardez les rendus des architectes, des urbanistes, des paysagistes, ils se déroulent toujours par un beau dimanche d’été …
Quels types de services pourraient alors naître de ces aménagements temporels ?
On peut imaginer beaucoup de services nouveaux qui iraient avec la transformation de nos usages. Par exemple les livraisons de colis. On pourrait les réceptionner dans les crèches, les gares, dans des lieux qui n’ont pas forcément les mêmes rythmes qu’une poste.
Il y a aussi des choses à tester selon les territoires, ville ou campagne. Cela signifie réactiver des lieux qui favorisent la rencontre. Dans les territoires ruraux par exemple, on pourrait utiliser les moments d’inactivé des ambulanciers et des taxis pour faire des livraisons à domicile. Développer en quelque sorte une souplesse des métiers, ce qui constituerait aussi la source d’un complément de revenus pour ces travailleurs.

La gare des Guillemins à Liège
Parlons de la participation des usagers à la gestion des villes. Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à gérer différemment nos villes ?
C’est une question piège car d’un côté la plupart des grandes lois territoriales votées ces trente dernières années, comme la loi Voynet ou la loi SRU par exemple, comportent un volet sur la participation des habitants. C’est prévu, mais cela ne marche pas, pourquoi ? Parce que nous sommes dans une démocratie représentative et pas dans une démocratie participative. Une démocratie représentative en panne, voyez le taux d’abstention…
Pour développer la participation, on pourrait par exemple abaisser l’âge du droit de vote à 12 ans, et encourager les enfants à participer très tôt aux décisions prises dans leur école. L’école deviendrait ainsi un lieu de démocratie directe, le pli serait pris de tout discuter tout le temps !
L’ensemble des décisions municipales pourrait aussi être discuté collectivement. Les gens ont beaucoup d’idées quand il s’agit de leur environnement proche. Il faut être beaucoup plus audacieux. Par exemple, donner la possibilité au gens de voter dans plusieurs endroits : où je dors – en banlieue parisienne dans mon cas – où je travaille, et aussi celui où je prends mes vacances, si l’on possède une résidence secondaire.
Ces nouvelles territorialités du politique devraient appeler à de nouvelles pratiques démocratiques. Avoir 36 000 communes en France peut être un atout à condition d’inventer une réelle démocratie locale. Il y a certainement des échelons territoriaux à revoir mais il serait bien de réfléchir à ce nouveau découpage du pays en ayant en tête de savoir si cela stimule la participation. Or les décisions continuent d’être prises d’en-haut, sans concertation, sans référendum. Et le taux d’abstention continuera de croître…
La démocratie participative ne se décrète pas mais se dessine au jour le jour, et nécessite du temps de parole, du temps pour se documenter, expertiser, argumenter, imaginer, discuter. Cela exige des « faiseurs de ville » d’abandonner leur jargon professionnel et de s’efforcer à écouter l’autre…
Et pour revenir à votre question concernant la cyberdémocratie, je pense que le « big data » ne sera toujours qu’un outil. Je ne pense pas qu’avoir à sa disposition toutes les informations pour décider soit suffisant pour modifier nos pratiques démocratiques. C’est une illusion de croire que les nouvelles technologies puissent le faire.

La ville sans la ville : ici le bidonville de Dahravi en Inde
Pour conclure, quelle serait votre vision de la ville idéale ?
A mon avis, la question ne se pose pas en ces termes. L’idéal c’est la ville, pas un idéal de ville. Pour cela je défends « l’esprit des villes ». Actuellement l’urbanisation planétaire s’effectue sans ville ou contre elle, je pense aux gated communities, aux bidonvilles, aux camps de réfugiés, aux gratte-ciel, aux lotissements pavillonnaires, par exemple. La terre est urbaine, les terriens sont des urbains, mais sont-ils citadins ? Ainsi la ville est en danger et c’est pourquoi, à côté du « droit à la ville », je réclame un « devoir de ville ».
On ne peut pas se sentir membre d’un territoire qui est peuplé comme un pays avec des millions d’habitants ou vaste comme une régions. Il y a une mesure démographique et géographique qui participe à la juste mesure urbaine. La ville idéale n’existe pas et j’espère qu’elle n’existera jamais, cela voudrait dire que tous les humains souhaitent la même organisation territoriale, je crois en la diversité des conditions d’habitabilité, en la combinaison de diverses manières de penser, de représenter et de vivre la ville…
Et pour en revenir à mes propos du début de notre entretien, je dirais que pour avoir conscience de cette combinaison des divers éléments constitutifs d’une ville, il faut revenir à la philosophie, ce cheminement de la pensée qui refuse aussi bien l’esprit de système que la fin de la contemplation.
(Propos recueillis le 25 juin)
